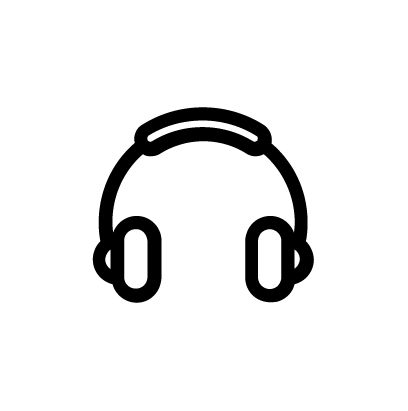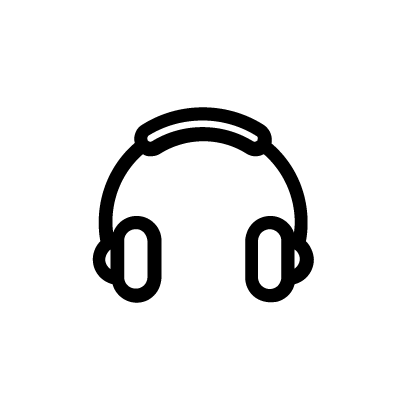Page découverte
La période swing

L’histoire a longtemps retenu la date du 21 août 1935 pour marquer le début de la « Swing Era » (l’ère du swing). Ce jour-là, au Palomar Ballroom à Los Angeles, le grand orchestre de Benny Goodman venu de New York (où le clarinettiste l’avait formé un an plus tôt) termine une tournée à travers les États-Unis dont le succès très relatif a laissé son chef dépité. Face à un public indifférent aux valses et autres danses qu’il leur propose, le clarinettiste joue le tout pour le tout en interprétant l’un de ses morceaux favoris : King Porter Stomp, un pur moment de jazz arrangé par Fletcher Henderson, musicien noir qui avait lui-même dirigé son propre big band quelques années auparavant. En quelques secondes, le public apathique se métamorphose et pousse des hurlements d’excitation, galvanisé par le rythme souple et entrainant de l’orchestre : il vient d’attraper le virus du swing. Porté par le bouche-à-oreille consécutif à ce concert, Benny Goodman reste finalement à l’affiche du Palomar pendant plusieurs semaines et regagne New York couronné du titre de « Roi du Swing ».
De très nombreux orchestres fleuriront dans son sillage, surfant sur cette vogue dansante qui popularise auprès de la jeunesse américaine le jitterbug et le lindy hop inventés dix ans plus tôt dans les dancings noirs de Harlem. Portée par le développement de la radio qui, via les retransmissions en direct, fait pénétrer la musique dans tous les foyers, cette Swing Craze (folie du swing) accompagne le retour de la prospérité économique, fruit du New Deal. Son rythme, irrésistible et joyeux, semble aller de pair avec le retour à l’optimisme de la société américaine sortie de la crise.
Or, à commencer par celui de Benny Goodman, le succès du swing se fonde sur un art avant tout inventé par des chefs d’orchestre africains-américains qui ont, pendant une décennie, développé une façon d’orchestrer la musique et d’organiser leurs formations, afin de donner envie au public de danser. En l’absence d’amplification, et afin de se faire entendre dans le brouhaha des grands dancings urbains, les big bands présentent une instrumentation densifiée, qui s’organisent en quatre sections : trois trompettes, trois trombones, quatre saxophones (qui alternent parfois avec la clarinette) et une section rythmique constituée d’un piano, d’une guitare, d’une contrebasse et d’une batterie. Élargis par rapport aux formations du jazz des origines, ces orchestres animent les grands cabarets chics de Harlem fréquentés par un public blanc fortuné, comme le Cotton Club, Small’s Paradise ou le Connie’s Inn, tenus par la pègre, les grandes salles de danse telles que le Savoy Ballroom ou l’Apollo Theater fréquentées par un public noir populaire et urbain à New York, mais aussi à Chicago, Detroit ou Kansas City, ville qui servait de base arrière à de nombreux orchestres sillonnant la région du Midwest.
Sous la plume des arrangeurs, les orchestres dégagent puissance et souplesse, jouent des associations de timbres originales, combinent les effets spectaculaires et les espaces dévolus aux interventions solistes, de manière à faire de chaque morceau un condensé de virtuosité et d’efficacité. Le registre expressif des solistes emprunte ses effets en partie au blues, notamment chez les trompettistes et trombonistes qui développent une palette de sonorités grâce à un éventail de sourdines et de growls (effet qui consiste à produire un son guttural tout en soufflant dans l’instrument, de manière à en altérer la sonorité et lui donner un côté sauvage, animal). Citons parmi les principaux chefs qui ont porté cet âge d’or des big bands à sa quintessence les noms de Fletcher Henderson, Jimmie Lunceford, Cab Calloway, Duke Ellington, Chick Webb, Count Basie, Andy Kirk, entre autres.
Auteur : Vincent Bessières


-au-Famous-Door-New-York-1947©-William-Gottlieb-Loc_350.jpg)