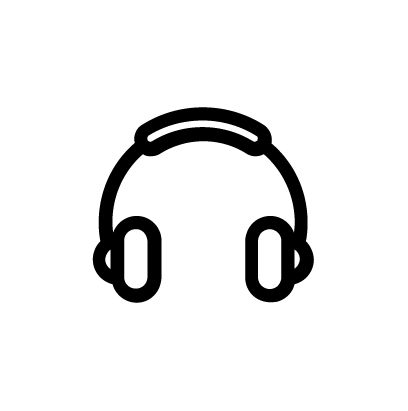Charles Lloyd (1938-)

Saxophoniste hors des modes et comme hors du temps, pour qui la pratique de la musique s’apparente à une recherche spirituelle, Charles Lloyd apparaît à l’aube du XXIe siècle comme l’une des dernières voix majeures – quoique sans réelle descendance – du jazz des années 1960. L’intense activité (tant scénique que phonographique) de ces dernières années contraste fortement avec des périodes de retraite et de silence qui avaient contribué à faire oublier ce musicien atypique, dans sa posture comme dans sa relative solitude, ayant développé au saxophone ténor une sonorité parmi les plus remarquables et des talents d’improvisateur capables d’être bouleversants.
De Memphis à Los Angeles
Né le 15 mars 1938 à Memphis (Tennessee, États-Unis), l’un des berceaux du blues et capitale de la « soul music », Charles Lloyd grandit dans une maison qui sert d’hôtel aux musiciens noirs de passage et fréquente très tôt un cercle des jeunes jazzmen appelés à se faire connaître en dehors de la ville : Frank Strozier, Hank Crawford, Harold Mabern, Louis Smith… Pris en main par George Coleman dans son apprentissage du saxophone alto dont il a commencé à jouer à l’âge de neuf ans en autodidacte, il est ami d’enfance du trompettiste Booker Little. C’est cependant le pianiste Phineas Newborn, éminent disciple de Bud Powell, qui tient le rôle le plus important : il lui fait entendre Charlie Parker, lui joue ses disques, et l’initie au be-bop. Néanmoins, ses débuts professionnels se font dans des formations de rhythm’n’blues emmenées par Johnny Ace, Bobby Blue Bland, Howlin’ Wolf et B.B. King.
En 1956, Lloyd s’installe à Los Angeles comme étudiant de la University of Southern California où il est élève de Halsey Stevens (spécialiste de Bartók), découvre les compositeurs classiques et contemporains et perfectionne ses compétences d’instrumentiste. Le soir, il fréquente les clubs de jazz, rencontre Harold Land, Scott LaFaro, Charlie Haden, Bobby Hutcherson, Buddy Colette… Il sympathise notamment avec le batteur Billy Higgins et appartient un temps aux rangs du big band de Gerald Wilson. Sur sa recommandation, il remplace Eric Dolphy en 1961 dans le groupe du batteur Chico Hamilton qui s’est fait remarquer par son instrumentation « de chambre » (avec violoncelle). Alors sous l’influence de Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins et Ornette Coleman, Charles Lloyd remodèle le format du groupe (dont il est devenu directeur musical) et renouvelle son répertoire. Incorporant le guitariste hongrois Gabor Szabo, le contrebassiste prodige Albert Stinson et un tromboniste, la musique prend une tournure nettement plus passionnée : passé au ténor (et ayant adopté la flûte), Lloyd est l’une des voix les plus ardentes. Ses thèmes empruntent au blues, offrent des structures ouvertes, révèlent l’influence des musiques orientales, restent attachés à la mélodie même s’ils libèrent les solistes (deux albums marquants sur Impulse, Passin’ Thru, 1962, et Man from Two Worlds, 1963). La plupart des conceptions qu’il définit alors seront durablement présentes dans son approche musicale.
Vague hippie
En 1964, installé à New York, il remplace Yusef Lateef dans le sextet de Cannonball Adderley, groupe qu’il quitte l’année suivante pour affirmer ses propres conceptions. Après des collaborations avec Gabor Szabo et différents musiciens proches de Miles Davis et John Coltrane, dont témoignent deux albums chez Columbia, il forme en 1966 un quartet avec Keith Jarrett, Cecil McBee (remplacé par la suite par Ron McClure) et Jack DeJohnette qui, en trois ans, connaît un succès international considérable (il est l’un des premiers groupes à être invité à jouer en URSS en 1967) et rencontre un public qui excède largement celui du jazz : publié par la firme Atlantic, Forest Flower, le disque tiré du concert qu’il a donné à Monterey en 1966, se vend à plus d’un million d’exemplaires et vaut au groupe de jouer dans des salles dédiées au rock comme le Fillmore de San Francisco et de partager l’affiche avec Jimi Hendrix et Jefferson Airplane. Controversée, la musique de Lloyd est alors perçue comme une version adoucie (dénaturée, selon certains) de celle de John Coltrane. En pleine vague hippie, son sens de l’extase, ses explorations modales inspirées des raga indiens, le lyrisme de son jeu de saxophone très extraverti, touchent une génération avide d’émotion « psychédélique ». Nourri de folk, de rock, et de soul music, Jarrett participe tout comme la batterie parfois binaire de DeJohnette, de cette musique fusionnelle, alternant les plages méditatives, les blues expressionnistes et les séquences plus emportées.
Passage à vide
Les années qui suivent seront aux antipodes. Après la dissolution du groupe en 1969, Lloyd, pour des raisons personnelles (décès de sa mère, toxicomanie), s'écarte de la scène et délaisse la musique. Il s’intéresse à la méditation transcendantale, s’installe à Big Sur dans une région encore sauvage de la Californie, face au Pacifique. Il enregistre quelques albums qui font écho à ses nouveaux centres d’intérêt spirituels très éloignés du jazz. Ayant sympathisé avec Mike Love, il apparaît sur plusieurs disques des Beach Boys et tourne avec eux. Il faut attendre jusqu’en 1981 et sa rencontre rocambolesque avec Michel Petrucciani (alors âgé de dix-huit ans) pour que se réveille la passion endormie de Charles Lloyd pour le jazz à son contact. Emerveillé par le talent et la personnalité bouillonnante du pianiste français, le saxophoniste forme un quartet avec Palle Danielsson et SonShip Theus qui porte Petrucciani à un niveau de reconnaissance internationale (leur concert au festival de Montreux en 1982 fait l’objet d’un disque) et ramène Lloyd dans l’œil public. Mais ce dernier disparaît à nouveau lorsque Petrucciani s'écarte de lui. Il ne reviendra au devant de la scène qu’en 1988, après être tombé gravement malade, avoir frôlé la mort et mesuré son attachement à la musique.
Retour à la scène
Dès lors, le retour de Charles Lloyd à la musique ne se démentira plus. Il forme un quartet avec des musiciens européens (notamment le pianiste Bobo Stenson) et, à l’instigation du producteur Manfred Eicher, enregistre à partir de 1989 pour le compte du label ECM une série d’albums qui consacrent sa renaissance. Celle-ci prend d’autant plus d’ampleur que débutent de nouvelles associations avec des musiciens d’envergure, notamment John Abercrombie et Dave Holland (Voice in the Night, 1998), Brad Mehldau et Larry Grenadier (The Water Is Wide, 1999)… Jusqu’à sa disparition en mai 2001, le batteur Billy Higgins s’avère un élément déterminant de la réussite de ces albums. Un dialogue improvisé en tête-à-tête en 2001 au domicile de Charles Lloyd dans lequel l’un comme l’autre ont recours à une pléthore d’instruments « ethniques » sera publié sous le titre de Which Way Is East ?. Il reflète l’intérêt grandissant du saxophoniste pour le taragot hongrois, le « hautbois tibétain » et la famille des flûtes mais aussi pour le saxophone alto, l’instrument dont il jouait au moment de sa rencontre avec Higgins et qu’il n’avait guère touché depuis des années.
Définitivement relancée, sa carrière s’appuie désormais sur des musiciens comme la pianiste Geri Allen, les contrebassistes Bob Hurst, Larry Grenadier et Reuben Rogers ou le jeune batteur Eric Harland. Ils renouent avec les grandes heures du quartet de Forest Flower, parcourant un répertoire où les compositions anciennes cohabitent avec d’autres écrites de fraîche date, où les spirituals voisinent avec des chansons signées Marvin Gaye ou Jacques Brel, magnifiés les uns comme les autres par une sonorité rêveuse au vibrato très ample du saxophoniste, un phrasé voluptueux aux contours flottants, dont certaines notes semblent plus suggérées qu’émises, et qui donne parfois le sentiment de s’enrouler sur lui-même. En 2001, il approfondit son attrait pour la musique indienne avec le percussionniste Zakir Hussain, avec qui il forme en 2004 un trio complété par Harland qui prend le nom de Sangam.
Auteur : Vincent Bessières
(mise à jour : juin 2006)
 Imprimer
Imprimer