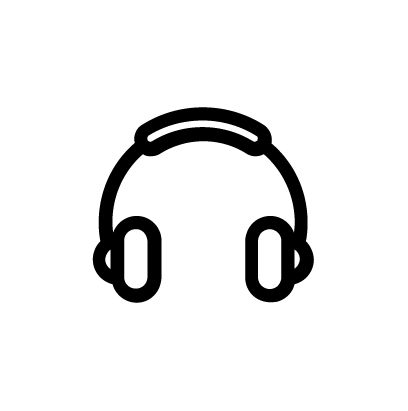Il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu débouler sur la scène du jazz un saxophoniste doué d’une virtuosité aussi étourdissante et possédé par une telle frénésie de jouer. C’est une évidence : ce jeune homme natif de Detroit – ville très spéciale dans la géographie musicale afro-américaine – d’emblée fascine et impressionne par son encyclopédique culture du jazz. Court-circuitant gaiement toute l’histoire du saxophone, James Carter réconcilie dans le feu de son jeu Coleman Hawkins avec John Coltrane, Ben Webster avec Albert Ayler. Jouant de sa prodigieuse mémoire, il connaît sur le bout des doigts tous les grands et petits maîtres, même les oubliés comme Chu Berry, Don Byas, Buddy Tate, Eddie Lockjaw Davis. Avec une désinvolture savante, sans l’ombre d’un pastiche, cet athlète des anches a décidé de mettre en mémoire tous les styles et de dévider tous les répertoires avec une impétuosité toute gourmande.
Virtuose sur tous les saxophones
Le jeu nomade de James Carter affirme le droit à une liberté de circulation entre les sons et les époques. Je ne cherche pas à brouiller les pistes mais je refuse, proclame-t-il, de me laisser enfermer dans une image. L’impossibilité de classifier un artiste, c’est le secret de sa longévité
. Quant à sa technique, dire qu’elle est phénoménale est un euphémisme. Justesse, précision, vitesse, tout y est. Tournoiements de registres, couinements subtils, claquements de langue staccato, allers et retours vertigineux du grave à l’aigu, grands écarts harmoniques, rien ne manque. Pendant un solo, les notes peuvent s’éparpiller furieusement de son sax pour tout à coup se rassembler, comme le mercure, en un son énorme, un souffle fou chaudement coloré de musique. De la langueur onctueuse au free frénétique, rien ne l’effraie. C’est que ce diable de jazzman aime prendre tous les risques. C’est avant tout un « saxomaniaque », un collectionneur, historien et réparateur fou de saxophones. Du sopranino au baryton, bien sûr, mais aussi du plus rare, le « freak » comme il l’appelle, un Fmezzo (instrument entre le soprano en si bémol et l’alto en mi bémol qui ne fut fabriqué par la firme Conn qu’entre 1928 et 1930), au plus gros, le basse à qui il sait donner comme personne l’ivresse des profondeurs. Je crois honnêtement qu’une personne n’a pas commencé à vivre tant qu’elle n’a pas joué du saxophone basse
.
Un tourbillon exubérant

Au début « bouillonnant », aujourd’hui magnifiquement maîtrisé, le style cartérien s’impose comme un tourbillon de styles où se télescopent en un bel élan expressionniste citations piochées aux meilleures sources, fragments d’autrui, extraits d’autrefois, éclats de demain. Mais attention, rien à voir avec le « revivalisme » savant prôné par Wynton Marsalis. Pour James, tous les styles de jazz appartiennent au même continuum. Je suis persuadé qu’une compréhension spirituelle permet de transcender tous les académismes
. Son art tient d’abord du patchwork, sa stratégie du recyclage, sa méthode du zapping. D’aucuns, agacés par son éclectisme forcené, ne voient en lui qu’un obsédé « saxuel ». Un improvisateur « sous influences » atteint de « pantagruélisme saxique » (Michel Contat). Bref, une sorte de CD-Rom vivant seulement capable de produire du jazz virtuel. D’autres, plus perspicaces, comme Jean-Louis Chautemps, saluent en lui le prototype du « musicien post-moderne ». À savoir celui qui s’accorde, sans états d’âme, le droit de renouer avec le passé et veut en finir avec la tyrannie de l’innovation
. Voilà qui n’est pas mal vu.
Sa généreuse hypertrophie du moi (mais ne pas être « égocentrique » n’est pas pour un artiste une faute professionnelle ?), son exubérance rentre-dedans, son exhibitionnisme naïvement arrogant ont pu agacer. Il y a chez ce jeune homme à la prestance altière un côté acteur très affirmé. À New York, où il habite depuis 1990, on appelle « Beau James » ce dandy des anches toujours tiré à quatre épingles qui parle à la perfection l’« ebonics », crypto-langage branché afro-américain propre à Big Apple. Mais l’important est ailleurs. Il est d’abord dans son formidable appétit de musique. Cet affamé permanent des jams est toujours partant pour les joutes fraternelles. Ainsi James Carter, fou de Django dont il connaît par cœur tous les solos (pour preuve, son album Chasin’ the Gipsy), n’a-t-il pas hésité à suivre en tournée américaine, juste pour le « fun », le guitariste manouche Dorado Schmitt. C’est la scène qui représente pour moi le lieu idéal pour ma musique
.
Auteur : Pascal Anquetil
(extrait des notes de programme du concert du 10 décembre 2003)
 Imprimer
Imprimer