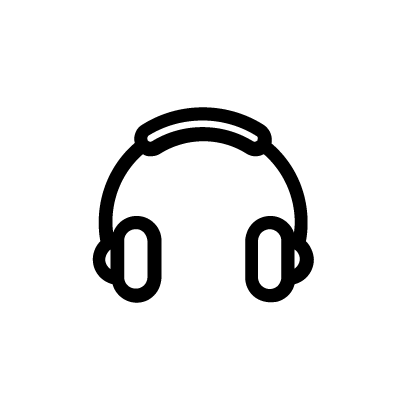Page découverte
Le Bourgeois gentilhomme Jean-Baptiste Lully

| Carte d’identité de l’œuvre : Le Bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Lully |
|
| Genre | ballet : comédie-ballet |
| Librettiste | Molière |
| Langue du livret | français |
| Composition | en 1670 |
| Création | le 14 octobre 1670 au château de Chambord, par la troupe de Molière, sur une chorégraphie de Pierre Beauchamp, avec des décors de Carlo Vigarani et des costumes du chevalier d’Arvieux |
| Forme | comédie en cinq actes entrecoupés de ballets |
| Instrumentation | ensemble instrumental variable, comprenant cinq parties (dessus, hautes-contre, tailles, quintes, basse), basse continue et percussions |
Genèse
Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-balletGenre dramatique, musical et chorégraphique qui traite de sujets contemporains de la vie quotidienne écrite en 1670 par Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Elle est constituée de cinq actes entrecoupés de balletsintermèdes.
C’est le 14 octobre 1670 au château de Chambord que le rideau se lève pour la première représentation de la pièce, devant le roi Louis XIV et la Cour.

À l’origine de la pièce, le désir du roi est de se divertir, mais également de se venger de l’affront que lui a fait l’ambassadeur du grand seigneur turc, lors de sa visite en 1669. En effet, ce dernier n’a pas témoigné toute l’admiration escomptée pour le faste déployé lors de sa venue. De plus, la France est à l’époque férue d’exotisme oriental, et la mode est aux « turqueries ». De la rencontre entre Molière et Lully naît ce que l’on considère comme le chef d’œuvre de la comédie-ballet : Le Bourgeois gentilhomme.
L’œuvre
Cette comédie-ballet résulte de l’association d’une pièce de théâtre (écrite par Molière), de musique (écrite par Lully), de ballets (chorégraphiés par Pierre Beauchamp), de décors (créés par Carlo Vigarani) et de costumes (créés par le chevalier d’Arvieux).
Ces différents arts s’entremêlent au sein de la pièce et font ainsi partie intégrante du déroulement et des rebondissements.
La pièce est donc organisée en cinq actes, entrecoupés d’intermèdes musicaux et/ou dansés, encadrés par une ouverture musicale et un final intitulé le Ballet des Nations.
Le schéma narratif de la comédie-ballet
| Comédie | Actes | Ballet |
| Ouverture en musique | ||
| Présentation : La personnalité de M. Jourdain Les désirs de M. Jourdain Les adjuvants de M. Jourdain Les opposants de M. Jourdain |
Acte I La comédie des maîtres |
|
| 1er intermède Dialogue en musique - danse |
||
| Acte II L’apprenti gentilhomme |
||
| 2e intermède Air des garçons tailleurs |
||
| Acte III Le bourgeois en famille |
||
| 3e intermède Danse des cuisiniers |
||
| Intrigues : Le mariage de la fille de M. Jourdain L’aventure amoureuse de M. Jourdain |
Acte IV La « réussite » du gentilhomme |
|
| Chansons à boire | ||
| 4e intermède La Cérémonie turque |
||
| Résultats : En apparence, un homme comblé En réalité, un homme bafoué |
Acte V L’échec du bourgeois |
|
| Final Le Ballet des Nations |
||
Argument

Monsieur Jourdain, riche bourgeois de condition, souhaite s’élever au rang de gentilhomme. Pour cela, il apprend les armes, la musique, la danse et la philosophie, qualités d’apparat du noble selon lui.
Il courtise la marquise Dorimène par le biais du comte Dorante, amant de cette même marquise. Celui-ci se joue de M. Jourdain en profitant de sa naïveté.
Sa femme, Madame Jourdain, et sa servante, Nicole, se moquent de lui et pensent au mariage de leur fille Lucile qui souhaite épouser Cléonte. Monsieur Jourdain s’y oppose, car ce dernier n’est pas noble.
Pour arriver à ses fins et entrer dans le jeu des illusions de M. Jourdain, Cléonte va orchestrer une farce avec l’aide de son valet Covielle : il se fait passer pour le fils du Grand Turc. Pour M. Jourdain, c’est la consécration : il est nommé « Mamamouchi », et se croit parvenu au plus haut titre de noblesse. Ainsi, cède-t-il la main de sa fille à un Cléonte déguisé et triomphant.
Le personnage de M. Jourdain

Molière incarnera lui-même ce personnage sur scène (Lully jouera le Grand Muphti). Il entend dénoncer le ridicule des bourgeois enrichis aux prétentions nobiliaires : il se place en juge impitoyable de son époque et, au-delà, de l’humanité.
M. Jourdain pousse à l’absurde l’ambition bourgeoise de tout acquérir à prix d’argent : la considération, les titres et les belles manières. Malgré sa naïveté et sa vanité, M. Jourdain reste néanmoins un personnage attachant.
Au moment de l’écriture de la pièce, la société est en plein changement. On divise habituellement la société de l’Ancien Régime en trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état, en distinguant de façon nette les roturiers des nobles. Cependant, au moment où Molière écrit, l’agencement de la société est plus complexe que celui décrit ci-dessus et Louis XIV est en train de le remodeler. Un grand nombre de roturiers peut maintenant avoir accès à des titres de noblesse.
Caractéristiques des thèmes : focus sur le Menuet et la Marche pour la Cérémonie des Turcs
Le Menuet (Acte II, scène 1)
Il s’agit du menuet joué et chanté pour la leçon de danse de M. Jourdain.
Le menuet est une danse populaire à trois temps, qui deviendra une danse de cour. C’est une des danses préférées de Louis XIV. Le tempo en est modéré, le caractère dansant, enlevé et rythmique. La structure est simple et efficace : deux phrases musicales A et B sont répétées selon la forme AABB, la fin de A étant identique à celle de B.
Le texte est constitué d’onomatopées « la, la, la », et de paroles lors du 2e A ainsi que dans B : en cadence s’il vous plaît, […], la jambe droite, […], ne remuez point tant les épaules, […], haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors, […], dressez votre corps
.
Ici, la musique est un prétexte et vient mettre en valeur le côté rébarbatif et peu évolutif du cours de danse de M. Jourdain. La simplicité de la structure et des mélodies employées convient donc parfaitement au caractère que revêt la pièce !
La Marche pour la Cérémonie des Turcs (Acte IV, scène 5)
La marche a pour fonction d’introniser M. Jourdain en tant que Mamamouchi.
Musicalement, c’est un genre marqué par une rythmique très présente qui sert à accompagner un cortège ou un déplacement. Le choix de la marche ici sert également à rendre ce moment solennel : en effet, M. Jourdain pense être consacré au plus haut rang de la noblesse.
Le tempo est enlevé et le caractère solennel et pompeux.
Pour exacerber l’ironie de cette scène, Lully emploie tous les instruments à sa disposition et utilise aussi des percussions aux sonorités orientales.
La marche est articulée autour de deux phrases musicales, A et B, structurées de la manière suivante : AAB et reprise de la fin de B. La netteté et la perception immédiate de la structure permet de donner un cadre très réglé et officiel.
L’utilisation de rythmes pointés accentue le caractère ironiquement sacré et majestueux de l’extrait.
Enfin, l’utilisation d’une tonalité mineure (sol mineur), qui confère un caractère plus grave à la pièce, finit de mettre en relief la double lecture de l’extrait : la fausse consécration de M. Jourdain.

Pistes pédagogiques
- Suggestions d’écoute
- Compositeurs français contemporains de Lully : Marc-Antoine Charpentier (l’Ouverture de La Descente d’Orphée aux enfers), Louis Couperin (la Chaconne de la Suite en fa majeur), Marin Marais (le Caprice de la Deuxième suite en sol majeur).
- Tragédies lyriques de Lully : Cadmus et Hermione (1673), Atys (1676) ou Armide (1686).
- Le Bourgeois gentilhomme de Richard Strauss, qui s’inspire de la pièce de Molière. Pour en savoir plus, lire la fiche dédiée à l’œuvre : https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0823561-le-bourgeois-gentilhomme-de-strauss.aspx.
- En lien avec Molière…
On peut lire ou regarder d’autres pièces de Molière comme Les Précieuses ridicules (1659), Les Femmes savantes (1672) ou encore Dom Juan ou le festin de pierre (1665) (repris par Mozart avec son opéra Don Giovanni (1787)). - En lien avec la comédie-ballet…
Regarder des extraits du Malade imaginaire (1673), fruit d’une collaboration entre Molière, Charpentier et Beauchamp. Pour en savoir plus, lire la fiche dédiée à l’œuvre : https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/1112192-le-malade-imaginaire-marc-antoine-charpentier.aspx.
Auteure : Anne Thunière
 de la Philharmonie de Paris.
de la Philharmonie de Paris.





![Plus d'infos sur 'Extrait du Bourgeois gentilhomme, Acte 2, scène 4, [Suivi de] Le Bourgeois gentilhomme (menuet)' Extrait du Bourgeois gentilhomme, Acte 2, scène 4, [Suivi de] Le Bourgeois gentilhomme (menuet) | Jean-Baptiste Lully](/images/DocThumbs/CMVI000144901_09.jpg)