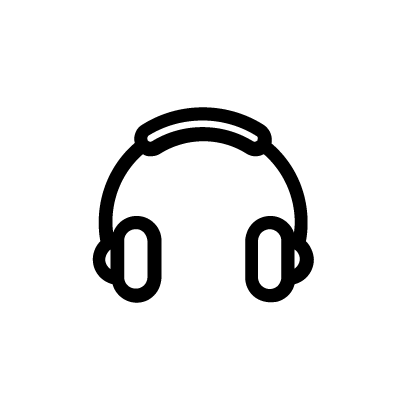Page découverte
Six Pièces de caractère op. 33 Christian Sinding

| Carte d’identité de l’œuvre : Six Pièces de caractère op. 33 de Christian Sinding |
|
| Genre | musique pour instrument seul |
| Composition | en 1896 |
| Forme | recueil de six pièces : I. A la menuetto II. Chant sans paroles III. Impromptu IV. Ständchen (Sérénade) V. Danse orientale VI. Scherzo |
| Instrumentation | piano seul |
| Orchestration | orchestration de la Danse orientale par Charlie Piper en 2010 |
Contexte de création et de composition

Toute sa vie, Christian Sinding écrit pour le piano des pièces faciles de salon, comme les Murmures du printemps par exemple, ainsi que des pages virtuoses dans le sillage de Franz Liszt, telles que le Caprice de l’opus 44. Il laisse également de brèves pièces lyriques à l’instar de celles d’Edvard Grieg, comme son opus 33 auquel appartient la Danse orientale, insérée entre une Sérénade et un Scherzo. Il était courant à l’époque d’intercaler une page orientalisante au milieu de pièces romantiques. Ainsi, dans son Album pour la jeunesse (1848), Robert Schumann glisse une pièce appelée Shéhérazade entre une Sicilienne et un Cavalier sauvage. La Danse orientale de Sinding a intéressé le public de son époque, et a d’ailleurs fait l’objet d’une orchestration par le compositeur Serge Taneïev, dont la partition est aujourd’hui disparue. C’est le britannique Charlie Piper (né en 1982) qui en réalise en 2010 une nouvelle orchestration colorée.
Focus sur Danse orientale
Sinding offre une vision de l’Orient très poétique mais qui relève davantage du fantasme que de l’authenticité musicale. La danse débute en douceur par une guirlande de tierces sinueuses jouées par la main droite. La main gauche place des accords en syncope, ce qui donne un léger élan à cette libre déclamation et imprime un ostinato lancinant propre à charmer les sens.

Le discours est parfois interrompu par des notes brusques, marquées et fortes, bref intermède avant de repartir dans l’ambiance initiale.
Dans la partie centrale, le thème passe alternativement de la main droite à la main gauche, soutenu par des accords se reposant cette fois sur les temps. Ils permettent de dresser un cadre stable toujours dans un esprit d’ostinato, répété inlassablement.

On entend clairement un jeu entre les modes majeur et mineur, tout à fait occidentaux. Assurément, on est encore là dans un langage romantique tardif.
Le retour de la première partie vient clore la pièce, qui s’achève avec délicatesse.
Auteure : Sylvia Avrand-Margot
 de la Philharmonie de Paris.
de la Philharmonie de Paris.