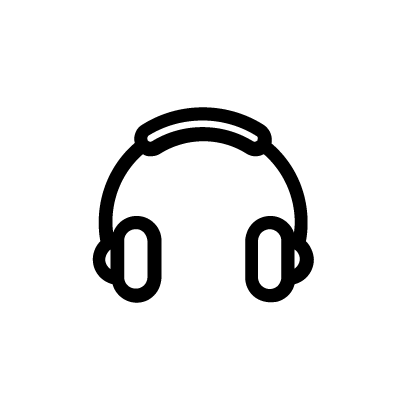Page découverte
Les Nuits égyptiennesAnton Arenski

| Carte d’identité de l’œuvre : Les Nuits égyptiennes d’Anton Arenski |
|
| Genre | ballet |
| Composition | en 1900 à Saint-Pétersbourg |
| Création | le 21 mars 1908, au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, par le chorégraphe Mikhaïl Fokine |
| Forme | ballet en un acte et treize numéros |
| Suite orchestrale op. 50a | |
| Genre | musique symphonique |
| Composition | en 1900 à Saint-Pétersbourg |
| Forme | suite composée de sept mouvements : 1. Ouverture 2. Danse d’Arsinoé et des esclaves (n° 3 dans le ballet) 3. Danse des Juives (n° 7) 4. Danse des Ghazies (n° 9) 5. Charmeuse des serpents (n° 10) 6. Pas de deux. Valse (n° 11) 7. Entrée solennelle d’Antoine (n° 6) |
| Instrumentation | bois : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons cuivres : 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba percussions : timbales, cloches, castagnettes, grelots cordes pincées : 1 harpe cordes frottées : violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses |
Contexte de création et de composition
Le titre du ballet, Les Nuits égyptiennes, rappelle celui d’une nouvelle de Pouchkine écrite en 1835. Mais en ce qui concerne l’histoire du ballet et cette plongée dans l’Orient, Arenski a puisé ses informations dans un ouvrage célèbre à l’époque d’Edward William Lane, Des mœurs et coutumes des Égyptiens modernes, publié à Londres en 1837. C’est un ouvrage qui fait date dans l’histoire de l’orientalisme par ses puissantes descriptions de la vie des Égyptiens, et qui inspirera plusieurs artistes dont Gérard de Nerval. Arenski compose un ballet en un acte et dix parties. Ce divertissement-ballet, destiné à l’origine au ballet impérial de Saint-Pétersbourg, ne verra pas le jour en raison du décès du chorégraphe Lev Ivanov. Il faut attendre 1908 et Mikhaïl Fokine pour le voir monté au théâtre Mariinsky, puis le 25 juin 1910, où il sera interprété par les Ballets russes de Diaghilev dans la production Cléopâtre au théâtre du Châtelet à Paris. Il figurait parmi plusieurs pièces réunies autour de la thématique « Les Orientales » en prélude à L’Oiseau de feu d’Igor Stravinski. Arenski propose, toujours en 1900, une suite d’orchestre à partir de ce ballet, son opus 50a.
Focus sur quelques mouvements de la suite
Danse des Ghazies
Cette valsedanse à trois temps commence en lourdeur. Les instruments graves appuient le premier temps alors que les castagnettes crépitent sur le deuxième. Se superpose un motif rythmique qui évoque la danse mais le ton est donné, on est bien là dans l’univers guerrier de ces Ghaziesguerriers religieux du Moyen Âge convertis à l’islam, pensant atteindre le paradis en se lançant dans de grandes batailles.

Sur cette basse solide vient s’ajouter une mélodie dansante, jouée aux cordes et aux bois.

On retrouve cet air joué avec douceur à la clarinette sur un accompagnement léger de cordes fuyantes comme des feux follets. Puis revient l’idée initiale dans un puissant tuttitout l’orchestre.
La seconde partie est tout en retenue. La flûte, soutenue discrètement par quelques percussions – les grelots et les cloches –, s’élève légèrement, dans un saisissant contraste : nuance piano, notes piquées...

alors que les cordes égrènent quelques notes en pizzicatoLes cordes sont pincées avec les doigts.. C’est un moment de calme et de douceur, précédant le retour de la première partie qui se termine avec panache, évoquant des guerriers triomphants.
Charmeuse des serpents
Cette pièce est assurément teintée d’éléments orientaux par l’emploi de modes arabisants et de leurs intervalles caractéristiques, ainsi que par le choix de l’instrument principal : le hautbois.
Pour camper cette femme indissociable de la magie des nuits d’Orient, Arenski fait jouer au hautbois seul une mélopée chromatique langoureuse. Des mélismes tortueux se déploient, révélant la sensualité de cette charmeuse de serpents qu’on imagine tout à fait mystérieuse. La mélodie seule commence avec une liberté d’interprétation indiquée dans la partition : accelerando = en accélérant, suivi de ritard. pour ritardando = en ralentissant, puis a tempo = en reprenant la vitesse initiale. Tout l’Orient se trouve dans cette mélodie.

Discrètement soutenu par un rythme syncopé aux cordes, ce thème continue d’évoluer au hautbois, bientôt rejoint par la flûte. Mais pas question de se laisser ensorceler par la langueur de cette mélodie. Voici bien vite un second thème, vif et agile, qui bondit et virevolte aux flûtes, hautbois et clarinettes dans une danse rapide et tournoyante. Quelques envolées du piccolo dans le suraigu, un léger crescendo, et voilà cette courte pièce rythmiquement compliquée qui s’achève avec des gammes montantes rapides et un trille finalbattement rapide de deux notes voisines pétillant.
Auteure : Sylvia Avrand-Margot
 de la Philharmonie de Paris.
de la Philharmonie de Paris.