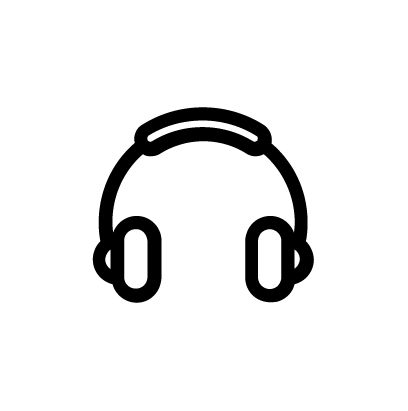Gerald Wilson (1918-2014)
Gerald Wilson fut l’un des derniers représentants des grands orchestrateurs issus de l’« ère swing », ce temps où le jazz était une musique de danse. Danse qui se devait d’être acrobatique et poétique, à la mesure des arrangements complexes et inouïs qui, autant que la virtuosité des solistes, suscitaient alors entre les big bands une compétition impitoyable…
Entre swing et be-bop
Né le 4 septembre 1918 à Shelby (Mississippi), Wilson grandit à Detroit et, s’il y a étudié la musique avec sa mère pianiste puis au fameux Cass Technical College, il s’est toujours considéré avant tout comme un autodidacte. Trompettiste, accessoirement tromboniste, ses dons d’écriture ont vite été reconnus et exploités par les plus grands chefs d’orchestre des années 1940. Il n’a que 21 ans lorsqu’il entre chez Jimmie Lunceford, succédant à Sy Oliver, l’un des plus géniaux arrangeurs de sa génération. Deux ans plus tard, il y signe deux pièces très avant-gardistes, « Hi Spook » et surtout « Yard Dog Mazurka », qui influencera Stan Kenton, affichant déjà son goût pour des rythmes peu usités en jazz et une façon très personnelle de jongler avec les unissons des diverses sections. Installé à Los Angeles, il y joue chez Benny Carter (autre arrangeur de génie) puis fonde son propre orchestre.
Son style va brusquement évoluer à partir de décembre 1945, date à laquelle il découvre Charlie Parker et Dizzy Gillespie lors de leur premier séjour sur la côte Ouest. Quatre ans plus tard, Dizzy l’engage dans son big band révolutionnaire, comme tromboniste. Ce n’est qu’une « couverture », car c’est pour ses talents d’arrangeur que ce chef de file du be-bop s’intéresse à lui… À la même époque, Wilson joue et écrit aussi pour Count Basie. Il se déclare ainsi comme l’un des rares « passeurs » entre deux époques du jazz : le « swing » et le « bop ». Certains de ses arrangements (comme « Katy ») sont d’ailleurs enregistrés à la fois par Basie et par Dizzy.
Orchestrateur en vogue
Au début des années 1950, les petites formations ont supplanté les grandes dans le goût du public. Même Basie doit se contenter d’un sextet. Très attaché au grand orchestre, Wilson préfère abandonner provisoirement la scène musicale. Il exerce la profession d’épicier, le temps de mettre assez d’argent de côté pour ressusciter l’orchestre de ses rêves. Ce sera, sinon le plus populaire, l’un des plus admirés par les jazzmen eux-mêmes : en 1963, il est n° 1 au referendum annuel de la revue Downbeat et triomphe au Festival de Monterey. Gerald Wilson redevient un orchestrateur en vogue : il écrit pour Ray Charles, Ella Fitzgerald et Julie London, pour Hollywood et la télévision. Il signe aussi pour Duke Ellington un fabuleux arrangement de « Perdido » pour l’album Piano in the Background (1960). Ce n’est pas par hasard que le Duke a fait appel à lui pour rénover ce chef-d’œuvre du portoricain Juan Tizol. À l’instar de Gil Evans, de Mingus et d’Ellington lui-même, Wilson est fasciné par le monde hispanique, et pas seulement par sa musique : il dédie certaines de ses compositions à ses toreros favoris…
Durant les années 1980 et 1990, Gerald Wilson continue de diriger son big band depuis Los Angeles. En 1995, la parution de State Street Sweet marque son retour dans l’actualité phonographique. The for Monterey (1998) composé sur une commande du festival de Monterey, et New York New Sound (2003) enregistré avec des musiciens de la Côte Est montrent que son talent demeure inépuisable. Aussi humble qu’exigeant, Wilson est un modèle de ce que les jazzmen appellent un musician’s musician
: toute son œuvre sans exception vise une perfection qui n’a été parfois perceptible, hélas, que par les musiciens eux-mêmes. Cela ne l’a pas empêché d’atteindre momentanément la célébrité, mais elle n’a jamais infléchi sa démarche, entre sa fidélité à un âge d’or du swing qu’il a eu la chance de vivre et un désir constant de contribuer à l’évolution de cette forme désormais « classique » qu’est le « big band de jazz ».
(d’après des notes de programme)
 Imprimer
Imprimer