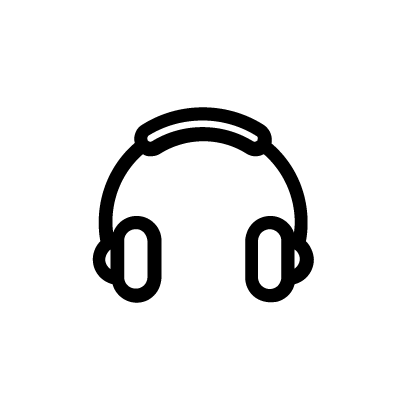Claude debussy (1862-1918)

Une bonne étoile…
Rien ne prédestinait le jeune Claude Son véritable prénom, Achille-Claude, lui déplaît : vers 1890, il choisit de se faire appeler Claude-Achille, puis finit par signer du simple prénom de Claude. Debussy à devenir cet artiste unanimement reconnu aujourd’hui. Il naît dans une famille modeste le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye. C’est l’aîné de cinq enfants. Sa mère, Victorine, une femme anticonformiste, décide de l’éduquer elle-même et Claude n’ira jamais à l’école. Son père, Manuel-Achille, enchaîne les déboires professionnels et peine à subvenir aux besoins de sa famille. Lors des événements de la Commune, il s’engage dans l’armée du côté des révolutionnaires. Ce choix lui vaudra un an de prison et quatre ans de privation de droits civiques. Aussi, Victorine se tourne-t-elle vers la tante et marraine de Claude, Clémentine Debussy. Installée à Cannes, sur les bords de la Méditerranée, sa situation lui permet d’accueillir généreusement son neveu. C’est lors de ces séjours que le jeune garçon a l’occasion de prendre ses premiers cours de piano, vers l’âge de huit ans. De son côté, son père rencontre en prison le fils d’une excellente pianiste, Mme Mauté de Fleurville. À Paris, où toute la famille vit dans un petit appartement, c’est elle qui décèle le talent de ce nouvel élève. Elle le prépare pour le Conservatoire de Paris où il est admis dès l’âge de dix ans.
Du piano à la composition
Au conservatoire, Claude montre déjà peu d’aptitude à suivre des règles, que ce soit la simple règle d’être à l’heure ou celles de la théorie de la musique. Mais son talent et son caractère séduisent.

Son professeur de piano, Antoine Marmontel, remarque vite ses dispositions : Charmant enfant
, note-t-il, véritable tempérament d’artiste ; deviendra un musicien distingué ; beaucoup d’avenir
On peut souligner qu’Antoine Marmontel emploie les mots de « musicien », d’« artiste », mais jamais de « pianiste ». Cette évaluation est en cela presque prémonitoire.. Si Debussy se montre curieux de tout, avide de se forger une culture à laquelle il n’a pas eu accès enfant, son travail est par contre irrégulier. Son professeur d’harmonie, Émile Durand, reconnaît d’ailleurs à l’adolescent un talent indéniable pour contourner les règles qu’il tente de lui enseigner et admet que évidemment, tout cela n’est guère orthodoxe, mais […] bien ingénieux
. Mais, en ce qui concerne le piano, le père de Claude doit abandonner l’espoir de le voir entamer une carrière lucrative d’interprète. Claude, après plusieurs tentatives, n’obtient qu’un second prix de piano. Petit à petit, un autre projet est né dans son esprit : celui de composer.
Nouvel horizon
Grâce à Antoine Marmontel qui connaît les difficultés matérielles de son élève, Debussy est employé plusieurs étés consécutifs dans deux riches familles en tant que pianiste. C’est pour lui à la fois un choc culturel et une formidable opportunité. Avec Marguerite Wilson-Pelouze, il découvre, en même temps que le luxe d’une demeure somptueusement parée d’œuvres d’art, une fervente admiratrice de la musique de Richard Wagner. Avec la famille de Mme von Meck, la protectrice de Piotr Ilitch Tchaïkovski, il voyage à travers l’Europe, à Moscou, à Florence, à Rome, et se familiarise avec la musique russe. Entretemps, au conservatoire, il suit brillamment la classe d’accompagnement où il obtient un premier prix qui lui ouvre les portes de la classe de composition. Élève peu conventionnel là comme ailleurs, son professeur Ernest Guiraud se montre patient et compréhensif, et Debussy, en 1884, obtient la plus haute reconnaissance pour un jeune compositeur : le premier grand prix de Rome, en présentant sa cantate L’Enfant prodigue, qui lui ouvre les portes de la Villa Médicis.
Un esprit indépendant
Comme pour tous les lauréats, ce prix induit qu’il doit rester deux ans à Rome, envoyer des compositions à l’Académie des Beaux-Arts puis voyager un an en Allemagne. Mais il démissionne en 1887. Sa musique commence à surprendre et à désorienter quelque peu les membres de l’Académie. Lui se sent déraciné et souhaite rentrer à Paris où l’attend d’ailleurs Marie-Blanche Vasnier Une chanteuse amateur mariée avec qui il entretient une relation amoureuse depuis plusieurs années ; Debussy connaîtra plusieurs histoires d’amour tumultueuses, créant parfois le scandale, jusqu’à ce qu’il rencontre Emma Bardac avec qui il aura une petite fille. qui est la dédicataire de la plupart de ses mélodies de l’époque. Debussy commence à rêver d’un opéra. En cette fin de décennie, il a l’occasion de découvrir plus largement la musique de Richard Wagner qu’il admire par-dessus tout. Pourtant, il cherche justement à s’exprimer d’une autre manière, presque diamétralement opposée à celle du maître de l’opéra allemand. Il est en quête d’autre chose et trouve partiellement une réponse en 1889, à l’Exposition Universelle où il découvre la musique du gamelan, un ensemble traditionnel de percussionsEnsemble traditionnel javanais, balinais ou sundanais, le gamelan est un orchestre de percussions mélodiques dont l’une des principales caractéristiques est que chaque exécutant a la responsabilité d’une formule rythmique. La complexité de la musique résulte alors de la superposition de ces différentes strates rythmiques complémentaires., et le théâtre de Cochinchine.
![Gamelan d’un régent (Java) / [photogr. reprod. par] Molténi [pour la conférence donnée par] Du Bois © BnF Gamelan d’un régent (Java) / [photogr. reprod. par] Molténi [pour la conférence donnée par] Du Bois © BnF](https://drop.philharmoniedeparis.fr/biographies/compositeurs/debussy-claude/Gamelan-d-un-regent-Java-photographi-reprod-par-Molteni-pour-la-conference-donnee-par-du-Bois©bnf.jpg)
Du Prélude à l’après-midi d’un faune à Pelléas et Mélisande
Mais c’est en fréquentant Stéphane Mallarmé que Debussy commence à trouver sa voie.

Il avait déjà mis en musique des poèmes d’un précurseur du symbolisme, Paul Verlaine, mais la rencontre avec l’écrivain amène Debussy à composer l’œuvre qui lui apporte son premier succès et dans laquelle il arrive à asseoir les bases de son langage, le Prélude à l’après-midi d’un faune. C’est en sa compagnie également qu’en 1893 il assiste à la première de Pélléas et Mélisande, du symboliste belge Maurice Maeterlinck. Debussy réalise que c’est la pièce de théâtre qu’il souhaite utiliser comme argument de son opéra. Commence alors un travail de longue haleine, qui aboutit en 1902, presqu’une décennie plus tard, à la création de l’œuvre qui révolutionne l’opéra. Loin des airs virtuoses et imposants de l’opéra romantique, la mélodie s’approche parfois de la déclamation et privilégie la compréhension du texte. L’orchestre, traité comme un personnage principal, dit en musique tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Employé comme un orchestre de chambre, avec peu de tuttiTerme italien qui signifie que tous les instruments de l’orchestre jouent., il ajoute à l’intimité des scènes et des personnages. Cet opéra est une œuvre charnière de la carrière de Claude Debussy. Elle lui apporte le succès et la reconnaissance.
Après Pelléas
Après 1902, Debussy connaît une période beaucoup plus productive. C’est l’époque de la création d’un important corpus d’œuvres pour piano, de la majeure partie de ses œuvres pour orchestre (dont La Mer), de recueils de mélodies et de la création d’œuvres originales pour le théâtre (telles que son ballet Jeux, composé pour les Ballets russes de Diaghilev).

La raison de cette productivité est sans doute aussi liée à sa situation matérielle. Il vit alors avec Emma Bardac qui, suite à un scandale amoureux provoqué par leur liaison, est déshéritée. Debussy a toujours eu des rapports difficiles avec l’argent et n’a pas de fortune personnelle. Pour subvenir aux besoins d’Emma et de leur fille, il tente de respecter les délais imposés par les multiples commandes. Ses sources d’inspiration s’éloignent du symbolisme et se tournent vers les œuvres du passé, notamment vers les poètes français anciens et la musique de Jean-Philippe Rameau (comme dans ses Images pour piano). Au moment où les tensions qui mèneront à la Première Guerre mondiale se font sentir, il exprime de plus en plus l’idée de revenir à une musique nationale et signe ses œuvres « Debussy, musicien français ».
Les dernières années
Le succès de son opéra a accéléré le rythme de représentation de ses œuvres qu’il doit accepter d’aller diriger à travers l’Europe au cours de voyages qui l’épuisent. À partir de 1909, les premiers symptômes d’un cancer se manifestent. Les tournées sont interrompues par la guerre, et les années qui suivent sont pénibles, entre les difficultés financières, la maladie, et la difficulté qu’a le public à comprendre ses œuvres récentes. Entre 1915 et 1917, Debussy compose ses dernières œuvres, toutes pour piano ou de musique de chambre. Il est opéré pour son cancer et suit des traitements lourds et difficiles, mais rien n’y fait. Il s’éteint le 25 mars 1918.
L’essentiel
- Claude Debussy est né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye et meurt le 25 mars 1918 à Paris. C’est le tournant d’un siècle et une période de grands bouleversements pour la société.
- Il entre au Conservatoire de Paris à 10 ans pour suivre des études de pianiste, mais choisit de devenir compositeur.
- Il est très attiré par les autres arts, notamment la poésie et la peinture. Il écrit d’ailleurs de nombreuses mélodies sur des poèmes, et sa musique est souvent comparée au mouvement pictural impressionniste.
- Il s’inspire de nouvelles sonorités, notamment de celles de la musique russe et des musiques extra-européennes qu’il a découvertes à l’Exposition Universelle de 1889.
- Son œuvre la plus importante est l’opéra Pelléas et Mélisande, qui l’occupe presque entièrement pendant de nombreuses années et qui lui vaudra la reconnaissance de son talent et de son originalité.
- Il connaît une intense période créatrice après 1902, autant par inspiration que pour pallier des difficultés financières. Avec l’âge, il ressent de plus en plus le besoin d’affirmer l’identité de la musique française et signe « Debussy, musicien français ».
Auteure : Aurélie Loyer
 Imprimer
Imprimer